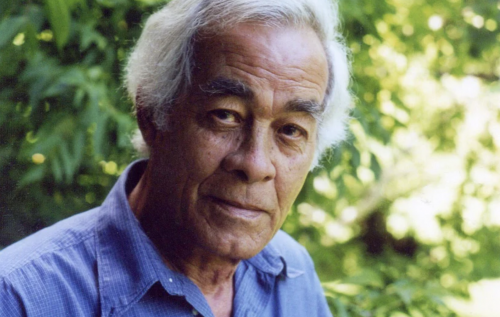L’humanitaire ambigu : Des usages stratégiques des images des « crises humanitaires » africaines
Après une décennie 1980 marquée par la contestation croissante des régimes autoritaires, par la mobilisation internationale contre l’apartheid et par la forte médiatisation de la crise éthiopienne, la fin de la Guerre froide a laissé augurer de l’ouverture d’une nouvelle page de l’histoire du continent africain. En dépit de quelques avancées réelles (conférences souveraines ; élections démocratiques libres en Afrique du Sud ; résolution de certains conflits), cette période post-guerre froide est d’abord celle de la résurgence des crises et des guerres sur le continent, avec ces trois « arcs de crise » majeurs que sont l’Afrique de l’Ouest (Liberia, Sierra Leone, Côte d’Ivoire…), l’Afrique centrale (Rwanda, Burundi, Congo…) ou encore la Corne de l’Afrique (Éthiopie, Érythrée, Somalie).
La majorité de ces conflits ont généré des situations de fragilité extrême pour des millions d’Africaines et d’Africains. Celles-ci ont pu conduire à des interventions d’urgence de la communauté internationale qui constituent aujourd’hui, pour l’historien, un terrain d’étude favorable à la compréhension du rôle joué à cette époque par les ONG humanitaires dans la mise en visibilité des conflictualités africaines. Dans quelle mesure la présence des humanitaires et leur stratégie de communication contribuent-elles à forger les regards occidentaux sur l’Afrique ? Quelles représentations sont produites et diffusées de ces interventions et des humanitaires par les journalistes occidentaux ? La communication des ONG occidentales a-t-elle parfois joué un rôle décisif dans le déroulement de ces conflits ?
Loin de prétendre à l’exhaustivité sur ce vaste sujet des liens entre médias et humanitaires, cet article livre quelques pistes de réflexion sur les représentations médiatiques produites et diffusées en France de la scène humanitaire en contexte de conflits et de violences extrêmes. Quelques études de cas (Rwanda, Darfour, Congo…) permettront de dégager les formes de narrations médiatiques qui se mettent en place pour couvrir ces situations tout en évaluant le poids de la communication des ONG humanitaires dans les représentations données d’elles-mêmes.
L’omniprésence de la scène humanitaire dans les conflits africains des années 1990-2000.
Les années 1990 s’ouvrent avec deux grandes crises majeures : la guerre en Somalie (1992-1995) et le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Dans les deux cas, ces événements multidimensionnels sont d’abord présentés par les médias français et occidentaux comme de gigantesques crises humanitaires qui nécessitent l’intervention de la communauté internationale.
La guerre en Somalie a principalement été couverte sous l’angle de l’aide apportée par les États occidentaux aux populations civiles. Cette couverture donne lieu à de nombreuses scènes montrant des enfants faméliques recevant des rations de riz — riz parfois débarqué à dos d’homme politique — sous la protection des soldats de l’opération militaro-humanitaire Restore Hope. Un débat traverse l’historiographie pour tenter de déterminer si les images de la détresse des populations sur CNN ont convaincu Bill Clinton de décider d’une intervention américaine (le fameux « effet CNN ») ou si celle-ci était déjà en préparation lorsque les médias américains ont commencé à s’intéresser à la situation somalienne. Il est sûr que la pression de l’opinion publique a permis au pouvoir politique d’annoncer cette décision dans des conditions favorables tandis qu’en octobre 1993, les images des corps des soldats américains trainés dans les rues de Mogadiscio ont contraint le Président américain à un retrait précipité.
L’exemple du Rwanda est tout aussi édifiant quant au poids des représentations médiatiques de la scène humanitaire. Alors que le génocide des Tutsis est peu couvert entre le 7 avril et la première quinzaine du mois de mai 1994, c’est la montée de la préoccupation humanitaire fin mai puis la mise en place de l’opération militaro-humanitaire Turquoise le 22 juin qui braque les objectifs du monde entier sur la situation rwandaise. Plusieurs centaines de journalistes français et étrangers couvrent par la suite, en juillet, la fuite de centaine de milliers de civils hutus vers le Zaïre. Ceux-là mêmes qui viennent de commettre le génocide sont alors présentés comme des êtres humains fragiles et menacés par le choléra, par l’avancée du Front patriotique rwandais et par des conditions sanitaires déplorables. Critiquée pour sa proximité avec les génocidaires, l’armée française retrouve ici son rôle d’institution protectrice des vies précaires et sa mission salvatrice, ce qui fera dire à Rony Brauman : « Quelle aubaine de voir un génocide transformé en vaste théâtre humanitaire où tous, rescapés, complices, innocents ou bourreaux prennent enfin la seule figure désormais convenable, celle de la victime. »
Quelques semaines plus tard, ces réfugiés rwandais ont constitué plusieurs camps dans l’Est du Zaïre, des camps rapidement pris en main par les anciennes autorités qui ont commis le génocide et qui bénéficient de l’attention et de l’aide internationale. Après de vives polémiques à l’automne pour savoir si les ONG devaient continuer d’accorder leur aide à ces réfugiés bien particuliers, l’est du Zaïre disparait des radars des rédactions occidentales jusqu’à ce que les camps soient attaqués à l’automne 1996 par une coalition de groupes rebelles dirigée par Laurent-Désiré Kabila et soutenue par le Rwanda voisin. Comme en juillet 1994, la communication des ONG et celle des autorités françaises sont à l’unisson pour dénoncer ces attaques, rivaliser de superlatifs pour qualifier la crise et appeler à la mise en place d’une nouvelle intervention humanitaire internationale. La logique humanitaire rencontre ici la logique politique dans la mesure où, pour les autorités françaises, il s’agit de freiner l’avancée de Kabila et de protéger le régime de Mobutu alors allié à la France. Le retour d’une partie des réfugiés au Rwanda, la communication habile de Kabila et les pressions américaines contribuent à enterrer durablement le projet de résolution français. Les alertes au printemps 1997 de plusieurs ONG lors de la découverte de charniers, à Tingi-Tingi par exemple, n’y changeront rien.
À partir de février 2003, au Darfour, une rébellion constituée de population Four, Massalit et Zaghawa se soulève contre le pouvoir de Khartoum. Ce dernier réprime la rébellion dans le sang en attaquant les villages considérés comme acquis à cette dernière et en exécutant ou chassant leurs populations. Femmes, vieillards et enfants se regroupent alors à la frontière voisine avec le Tchad, dans des camps bientôt immenses. Si le conflit ne suscite que peu d’attention de la part des médias durant sa première année, les alertes des humanitaires et de l’ONU, dans le contexte de la 10e commémoration du génocide contre les Tutsis, génèrent une série de reportages de télévision dans les camps de réfugiés au Tchad. Des scènes répétitives sont alors proposées aux téléspectateurs français, successivement confrontés à l’isolement des camps, à la précarité des femmes et des enfants du Darfour, à l’expertise des ONG et du HCR ou encore et à l’évocation de la menace persistante des cavaliers janjawids et des troupes soudanaises qui empêche toute possibilité de retour.
Des représentations médiatiques figées et stéréotypées.
S’il n’est pas possible de revenir de manière détaillée sur la diversité des représentations médiatiques observées dans les différentes études de cas conduites, plusieurs remarques doivent à ce stade être mises en avant.
Tout d’abord, bien qu’elle ne soit pas forcément décisive, la communication des humanitaires est un élément à considérer pour comprendre le choix des rédactions de mettre ou non en visibilité un conflit. Si ces alertes n’ont pas suffi en avril 1994, lors des débuts du génocide des Tutsis, elles ont en revanche été fondamentales au Zaïre à l’automne 1996, puis au Darfour au printemps 2004. Pour parvenir à orienter le regard des journalistes, les ONG humanitaires doivent d’abord disposer d’une certaine marge de manœuvre autorisant le déploiement d’une campagne de communication efficace sans mettre en danger leurs équipes sur le terrain. Cette communication ne bénéficie d’une forte crédibilité et d’une large audience que dans le cas où leur présentation des événements correspond à celles d’autres acteurs influents, et en premier lieu à celle de l’exécutif français. Dans le cas contraire, leurs discours restent le plus souvent peu audibles et peu visibles à moins qu’une polémique ne se crée comme cela a été le cas lors de la dénonciation à la mi-mai 1994 par MSF des proximités du pouvoir français avec les auteurs du génocide en cours.
Une seconde remarque importante porte sur la relative stabilité des représentations de la scène humanitaire observées durant cette période. En dépit de la diversité des contextes, le prisme humanitaire conduit à une focalisation de l’attention des publics sur les civils et sur la périphérie des combats, avec la diffusion d’images et de termes très stéréotypés.
Plusieurs grandes figures extrêmement classiques — qui rappellent le Biafra ou l’Éthiopie — se répètent alors, quel que soit le terrain d’opération. L’étude des formes iconographiques des représentations médiatiques a ainsi révélé sept modalités principales de mise en images.
De même, l’évocation de la mort — comme menace lointaine, imminente ou comme déjà effective — est aussi un des leitmotivs de la couverture de ces événements, lorsque le prisme humanitaire s’impose.
Enfin, l’étude de la répartition des rôles entre les acteurs représentés permet de dégager plusieurs structures dominantes dans les formes de mise en narration de ces conflits.
D’abord, la persistance d’une logique binaire dans laquelle les acteurs blancs sont le plus souvent placés dans une position d’acteurs majeurs livrant expertise, conseil, aide et soutien et constituant des solutions à la crise ; à l’inverse, les acteurs noirs sont le plus souvent réduits au rôle de victimes passives d’un destin qui les dépasse ou à celui de bourreaux responsables de la situation.
Ancrées dans le réel, ces représentations doivent cependant être lues comme une réduction de la diversité des situations dans la mesure où l’agence des acteurs africains se trouve souvent euphémisée, voire effacée.
Ces représentations binaires constituent le cadre de mises en narration médiatiques fondé sur le triptyque classique de la victime, du sauveur et du bourreau.
Dans ce récit médiatique dominant, les acteurs français (responsables politiques, militaires, humanitaires) tentent de venir en aide à des populations africaines menacées par des groupes militaires, des miliciens ou une épidémie.
Les ONG humanitaires, co-productrices d’une narration médiatique à forte valeur stratégique.
L’omniprésence de ces scènes n’est pas a priori une surprise dans la mesure où elles constituent une partie de la réalité de la vie des camps et des réfugiés et possèdent à ce titre une valeur informative.
Pourtant, comment comprendre que, malgré la diversité des contextes et des rédactions, les journalistes optent pour le recours assez systématique aux mêmes scènes, aux mêmes images, aux mêmes procédés narratifs 18 ?
Pour comprendre le poids de telles représentations, trois types d’explications doivent a minima être mobilisées. La première concerne les routines inhérentes à la production de l’information.
Les journalistes font en effet le plus souvent surgir de leurs observations des scènes considérées comme immédiatement intelligibles pour les lecteurs ou les téléspectateurs, des scènes qui puissent incarner de manière efficace l’urgence d’une situation ou sa dimension tragique ; le recours aux stéréotypes permet à ce titre de faciliter la compréhension du public. Ajoutons à cela que les images de la scène humanitaires permettent d’« angler » les sujets sur les guerres africaines et de les inscrire dans une logique de dénonciation (de la guerre, des massacres, de l’isolement des populations…).
Il faut aussi souligner la forte interdépendance entre les journalistes et les humanitaires ainsi que les porosités entre la rhétorique humanitaire et le discours journalistique. S’il n’est pas possible d’aborder ici toute la complexité de ces liens 19 , les journalistes s’appuient sur les humanitaires pour avoir des informations sur la situation sans dépendre des belligérants et les humanitaires jouent un rôle majeur d’expertise et d’évaluation de la situation.
Les ONG humanitaires sont précieuses pour accéder de manière sécurisée aux populations, pour choisir les « bons témoins » et pour capter des images spectaculaires et/ou choquantes qui vont permettre de nourrir les productions médiatiques sur le thème de la « catastrophe humanitaire ». Réciproquement, les humanitaires mobilisent les journalistes afin de faire connaître leurs actions et de lancer des appels aux dons ; ils les accueillent ainsi dans leur siège parisien à des fins de communication, leur fournissent un accès au terrain et souvent des images et des rapports sur la situation sur le terrain 20 .
Enfin, et c’est sans doute là l’essentiel, la mise en narration des souffrances des populations africaines revêt des enjeux majeurs pour un grand nombre d’acteurs qui peuvent avoir intérêt à alimenter ces récits et à les co- produire. La mise en visibilité de ces souffrances peut en effet servir d’outil de délégitimation d’un adversaire ou de moyen de mobilisation de l’aide alimentaire pour la détourner ensuite 21
Ces récits peuvent aussi avoir pour rôle de légitimer un engagement (dans le cas du Rwanda, mettre à la « une » les images de la
« catastrophe humanitaire » a pu permettre aux autorités françaises de montrer la légitimité et l’utilité d’une opération Turquoise pourtant fortement critiquée à l’origine) ou de manifester la puissance d’un État occidental.
Dans tous les cas, ces récits médiatiques constituent de redoutables outils de mobilisation des opinions publiques en faveur d’une cause ou d’obtention du consentement d’une population à une intervention militaire.