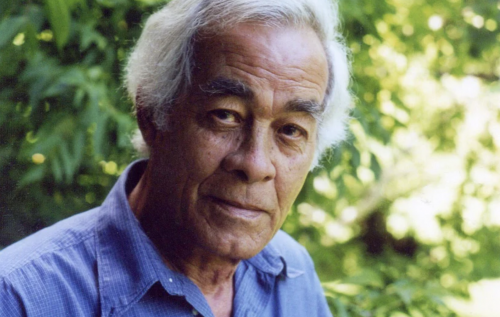Enseignement, professionnalisation. Apparition de nouveaux enjeux au Nord comme au Sud.
Pensez-vous que la façon dont la coopération est enseignée aujourd’hui a un impact sur la communication des ONG?
Il y a deux types d’enseignements dans les Masters et Bacheliers en coopération. On forme les élèves à des disciplines de sciences sociales telles que sociologie, anthropologie, etc. Mais surtout, on les forme à développer des outils plus techniques, de type « management ».
On duplique assez rapidement les stéréotypes et mimiques d’un secteur que l’on est pourtant censé analyser. Normalement, on devrait avoir du recul par rapport au secteur du développement, mais ce n’est pas toujours le cas. Il y a aujourd’hui une approche beaucoup plus managériale, un nouveau modèle de professionnalisation, ce qui élague donc de plus en plus l’approche critique. Cela façonne donc par la suite des acteurs de la coopération qui ont moins développé cette réflexion.
Constatez-vous une évolution dans la façon dont on enseigne la coopération aujourd’hui?
Oui, cela a beaucoup évolué. Avant les études de développement se commençaient au niveau du troisième cycle. Aujourd’hui, c’est au second cycle. Les écoles ont évolué vers une exigence d’insertion professionnelle, avant, il y avait aussi d’autres possibilités. Avant on était d’abord médecin, juriste, vétérinaire avant d’être formé à la coopération. Aujourd’hui, on est formé juste à la coopération en tant que telle. C’est donc une formation un peu généraliste, orientée vers la transmission de techniques. La mise à distance critique est peut-être donc moins exigée qu’elle ne l’était avant dans la formation de troisième cycle, formation qui valorisait le doctorat. La recherche est de moins en moins valorisée dans les études de développement.
L’exemple est significatif à mon université, à Liège. Le master de développement est divisé en deux filières : l’une professionnelle et l’autre recherche. Dans le ratio d’inscriptions, sur 20 étudiant.e.s, il y en a 2 qui choisissent la filière recherche. Les étudiants veulent un master qui va vers des métiers, ce qui pose problème par rapport à la recherche en elle-même.
Sans doctorat sur la coopération, c’est difficile de guider, d’aider dans le domaine, d’avoir une réflexion approfondie sur les pratiques d’aide.
Est-ce qu’il y a toutefois une réflexion dans le secteur de la coopération sur le fonctionnement des ONG ?
Oui, la réflexion se fait à travers des mémoires, mais pas nécessairement dans les Masters de développement. J’essaye d’insuffler, de proposer des mémoires sur ce thème dans les Masters de communication, etc.
Il y a également un enseignant à Liège qui s’appelle Frédéric Thomas il travaille au CETRI (Centre Tricontinental) et il travaille sur l’aide humanitaire en Haïti. Il décortique le travail des ONG et la communication des ONG. Il a écrit notamment un ouvrage intitulé L’échec humanitaire, le cas haïtien.
Vous travaillez beaucoup sur la société civile en Afrique, quel rôle a-t-elle joué dans les dynamiques de développement?
Oui, j’ai travaillé sur la question depuis mon doctorat. La notion de société civile est vraiment aujourd’hui consacrée par les politiques de coopération. Elle est apparue dans le champ de la coopération dans les années 1980 dans le cadre de l’effondrement des régimes communistes et d’une tentative de passage vers des régimes démocratiques en Afrique. On avait donc une image positive de la société civile comme acteur central du fonctionnement de la démocratie.
On pense notamment aux travaux de Robert Peutnam (théorie du capital social) qui a essayé de montrer le lien entre le fait de disposer d’une société civile structurée et de bénéficier aussi d’un développement à la fois politique et économique. Ainsi, la banque mondiale a trouvé comme justification la société civile pour son action.
Aujourd’hui, on ne peut plus mettre en place des programmes de coopération sans prendre en compte la société civile.Il y a un formatage et une orientation du visage de la société civile, non pas vers un rôle de la population, mais vers un rôle de tiers secteurs.
Depuis le début des années 2000, on a pu constater une société civile à deux vitesses. D’une part une minorité d’acteurs qui travaillent dans la coopération, qui sont formatés et maitrisent des cadres logiques, des outils de la coopération. Ces acteurs étaient parfois mieux formés qu’au Nord.
D’autre part une multitude d’associations qui ne sont pas parvenues à rentrer dans les réseaux de soutien transnationaux. Ce sont des structures qui vivotent, qui se débrouillent avec les moyens du bord, mais qui sont moins formatées et peuvent donc avoir une dimension plus contestataire.
La société civile est un trompe-l’œil quand on en parle dans la coopération. Cela questionne sur la représentativité de ce que l’on considère comme « société civile ».
Quand on voit toutes ces organisations très bien structurées « au Sud », quel rôle ont donc à jouer les organisations « au Nord »?
Les ONG ont essayé d’arrêter les modèles d’intervention où l’ONG se substitut au partenaire Sud. Aujourd’hui une ONG sans partenaire ça n’existe pas. Il faut être partenaire quand on prétend faire de la coopération au Sud. Elles ont plutôt aujourd’hui un rôle d’accompagnatrices, d’encadrement, de soutien logistique et financier. Les compétences sont de plus en plus situées au Sud. Une autre orientation que les ONG ont du prendre, c’est développer le volet Nord.
Mais là encore il y a un problème : c’est l’héritage de l’éducation au développement. Le discours paternaliste persiste, surtout, sur la forme lorsque l’objectif premier est la récole de fond. Aujourd’hui quand on parle de développement à la citoyenneté mondiale, ce n’est plus seulement une question de forme et de récolte de fonds. Il faut aussi communiquer sur les enjeux du Sud, conscientiser etc.
Nous sommes dans un monde globalisé, mais la globalisation peut aussi amener à un repli sur soi: si on s’intéresse au nord on peut se dire: il y a déjà des problèmes ici, alors ne ne nous intéressons plus autre autre. C’est un danger dans lequel il ne faut pas tomber.
Comment expliquez-vous que cette vision n’ait pas évolué dans les agences de communication notamment ?
Le problème réside dans le discours affiché: « nous sommes des partenaires, nous mettons en place des projets, etc. ». Mais le problème c’est que le partenariat suppose équivalence dans les termes. Si l'on intervient dans un pays du Sud c’est qu’il y a un déséquilibre, toujours en faveur du pays qui donne.
Ainsi on assiste à une sensibilisation qui répond à des fonds privés. La communication doit parler aux populations occidentales pour qu’elles aient envie de donner de l’argent. Et la communication telle qu’elle est définit au nord répond à des codes culturels et sociaux typiques du nord.
Il apparaît que cette communication échoue à interpeller les populations au Nord dans leur diversité. De plus, elle propage des stéréotypes qui ont un impact sur les africain.e.s en Europe. Quelles solutions sont possibles selon vous?
Il faudrait une enquête systématique et approfondie sur le sujet. En partant de cette approche, il faudrait filtrer la communication, pour démontrer la prolongation, construction et mise en image de stéréotypes. C’est encore plus grave en ce qui concerne l’aide humanitaire: parce qu’on a moins de recul sur la mise en scène d’une crise humanitaire. En même temps, avec le nombre de crises qu’il y a on ne me fera pas croire qu’une organisation n’a aucun recul.
Comme amorce de solution, il faudrait qu’à côté de cette enquête systématique il y ait un jury d’éthique ONG qui dit « nous nous engageons à ne pas reproduire des schémas ». Il faut que toutes les ONG soient signataires d’une charte de bonne conduite. Beaucoup d’acteurs du monde des ONG pensent comme vous, mais après ils sont coincés par une obligation de moyens, récolter des fonds pour faire vivre les projets, faire vivre la structure. On sait bien que montrer la misère rapporte plus d’argent , que montre une Afrique qui gagne.
Par rapport à la crise en Haïti, ou autres crises humanitaires, pensez vous qu’il est justifié d’avoir recours à des images choquantes quand il faut mobiliser dans un temps court?
Non, la fin ne justifie pas les moyens…mais il y a tellement de cynisme ! À court terme ça marche évidemment. En Haïti notamment, très vite les ONG ont été dépassées par l’aide apportée. Mais communiquer sur la misère ça ne rend pas solidaire.
Le caritatif n’est pas de la solidarité. Pour qu'il y ait de la solidarité il faut que je me dise: c’est un humain, quelqu’un digne d’humanité, quelqu’un qui est comme moi. Alors que dans le caritatif, vous n’avez pas besoin de penser que l’autre est égal à vous; l’autre est différent de vous. On peut se montrer caritatif vis-à-vis des animaux, on n’est pas solidaire des chiens, mais on peut financer la SPA.
À la fin cela crée deux effets: on lasse les gens et on mobilise toujours sur le même registre, donc on renforce les stéréotypes.
Moi je suis un enfant de la crise éthiopienne des années 1980. Quand on dit aujourd’hui que l’Éthiopie c’est un pays vert, qu’il y a des immeubles, des richesses, que ce pays n’a pas été trop colonisé, les gens sont étonnés. La population belge quand on lui dit Éthiopie elle pense famine, plaine désertique. Il faut faire ce travail de déconstruction.
Pourquoi est-ce qu’on aide encore? La coopération n’est ce pas finalement « une industrie qui s’autoalimente de la misère? »
Il y a une sorte d’ambiguïté autour de la coopération. Quand on parle des acteurs de la coopération, de l’aide publique au développement, il faut bien rappeler que cela reste une politique publique. Il y a donc un intérêt pour le rayonnement des états. Pendant toute la guerre froide, c’était une question d’enjeux stratégiques. On s’arrachait le Bénin pour éviter que cela ne tombe dans les mains d’un camp ou d’un autre. Sans la guerre froide, l’aide avait beaucoup moins d’intérêts. D’ailleurs dans les années 1990 on a vu une chute constante de l’aide, il n’y avait plus d’intérêt pour les états.
Aujourd’hui, il y a de nouveaux intérêts avec les migrations, etc. Il y a toujours de nouvelles justifications étatiques pour la coopération. La coopération est un instrument des politiques publiques.
L’ambiguïté réside dans le fait qu’on utilise le mot coopération comme si c’était un synonyme de solidarité. La coopération ce n’est pas être solidaire, c’est intervenir dans un pays parce qu’on y a des intérêts. Mais il persiste cette confusion alimentée entre solidarité et coopération, comme si les deux secteurs ne faisaient qu’un.
Cependant, il y a un très grand nombre d’IPSI (Initiatives Populaires de Solidarité Internationale). Ces initiatives s’expriment davantage au nom de cette solidarité. Pour une ONG il y a dix IPSI.
Cela signifie qu’il y a une dynamique sociale au Nord, qui exprime toujours une volonté de solidarité. Cette dynamique solidaire est loin de s’estomper, dans un monde globalisé, parce qu’on est au courant de tout très vite. Il y a aussi ce problème de « monsieur tout le monde » qui, pétri de stéréotypes, veut aller aider aussi les pauvres petits africains.
Il y a également aussi beaucoup d’argent injecté par la diaspora au Nord dans les pays au Sud. N’est-ce pas là un enjeu majeur?
Oui, la diaspora a une place importante. Cela est des flux privés qui circulent dans des réseaux informels, mais qui sont dix fois plus importants que les fonds diffusés par l’aide publique au développement.Il y a d’ailleurs la question dans le pays africain de voir comment prendre en compte apport de la diaspora dans les calculs des budgets.
Le souci avec ces réseaux informels c’est que cela reste des flux privés qui circulent dans des projets privés. Cela fait fonctionner des pays, mais sur base de projets individuels, familiaux. Je ne suis pas sûr que l’on puisse développer un pays à partir de fonds privés. Est-ce que par exemple on peut vacciner tout un pays à partir de l’argent privé des diasporas? On a toujours besoin des organisations internationales, des puissances publiques pour coordonner tout ça.
On ne pourra pas éliminer la coopération du jour au lendemain…
L’enjeu se situe plutôt non pas dans la fin de la coopération ni dans l’hyper valorisation des diasporas, mais plutôt dans la jonction, et dans l’éducation des populations qui veulent faire de la solidarité. Il faudrait arriver à joindre les dynamiques citoyennes avec les dynamiques de coopération. Cela permettrait d’éviter les dérives stéréotypées et le repli sur soi.
De plus, il ne faut pas oublier que dans l’argent versé par l’aide publique au développement, il y a beaucoup d’argent qui revient dans les économies occidentales, beaucoup d’argent détourné qui revient dans des fonds offshore. Il faudrait déjà réglementer cela.
Face à tous ces enjeux de pouvoir et d’intérêt, pourquoi n’y a-t-il pas un questionnement politique au sein même du secteur de la coopération?
Les ONG répondent aujourd’hui à une logique de survie, à une logique de maintien de l’outil. On se plie à beaucoup de directives.
L’illustration de cela est selon moi le passage de l’éducation au développement à l’éducation à la citoyenneté mondiale. A priori, c’est une bonne chose ! C’est bien d’éduquer à la citoyenneté mondiale ! Le terme « éducation au développement » c’est vrai que ça sonne dépassé.
Cette nouvelle approche cherche à réduire l’axe nord-sud et à réfléchir en termes de globalisation. Mais on bascule aussi dans l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire parce que cela permet de développer de nouvelles activités sous une nouvelle étiquette. On voit apparaître des « cours de rien » appelés cours de citoyenneté, là on va pouvoir développer de nouvelles activités, de nouveaux marchés.
La question aujourd’hui pour beaucoup d’acteurs de la coopération c’est= quelle est la place encore du sud dans notre réflexion? C’est quoi notre marque de fabrique si l'on travaille sur l’ensemble de la planète? Dans l’éducation à citoyenneté mondiale c’est la même chose: on cherche à éduquer/sensibiliser sur des pb non plus Nord/Sud, mais sur les rapports de la planète. Cela enlève la réflexion sur l’identité des ONG, il n’y a pas de réflexion sur leur essence. Alors que ces ONG sont les enfants de la pensée tiers-mondiste, elles sont nées dans les années 70, elles se sont créées en mode nord-sud.
Je garde la conviction que les problèmes rencontrés au sud dans ce monde globalisé sont particuliers. Que la période coloniale ait joué un rôle, que dans le même registre, il y a un système d’économie-monde qui s’est mise en place depuis le 16e siècle et que ce système d’économie-monde a réparti les rôles dans les économies en faveur des économies du Nord et pas du Sud.
C’est très difficile de passer au Nord quand on est au Sud: ça, c’est héritage de la pensée marxiste, aujourd’hui ce discours la n’est plus audible, on en parle plus dans le secteur de la coopération. On parle beaucoup plus maintenant de théorie managériale, etc.
C’est dommage parce qu’une lecture marxiste du monde permettrait de mieux comprendre le Sud.